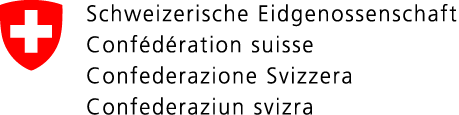Les fausses informations diffusées sciemment sont omniprésentes sur les médias sociaux et autres plateformes numériques. De nouvelles études commandées par l'OFCOM mettent en lumière les facteurs décisifs du phénomène.
Entre éducation aux médias et algorithmes: Recherche sur la désinformation sur les plateformes numériques

Thomas Häussler, Division Médias
Les plateformes numériques telles que YouTube, Instagram ou TikTok permettent d'accéder à des informations, d'échanger des idées et des opinions et de se mettre en réseau avec d'autres personnes, mais elles posent aussi des défis considérables, comme la diffusion de la désinformation (voir rapport de l'OFCOM "Intermédiaires et plateformes de communication" de novembre 2021). Les utilisateurs de ces plateformes, lesquels réagissent souvent plus fortement aux contenus émotionnels ou polarisants, ne sont pas les seuls à alimenter le flot d'informations fausses ou trompeuses. Les algorithmes, par exemple ceux des moteurs de recherche comme Google, jouent également un rôle décisif puisqu'ils déterminent quels contenus apparaissent en tête de liste, et ont donc une meilleure visibilité, et plus de clics.
Cette situation soulève des questions de recherche qui ont été traitées dans le cadre de différents projets cofinancés par l'OFCOM. Une première étude a cherché à déterminer l'importance de la désinformation sur les plateformes numériques. Une autre a examiné dans quelle mesure les utilisateurs sont capables d’identifier la désinformation, tandis qu'une dernière a cherché à cerner l'effet de la désinformation non seulement sur la formation de l'opinion pour un sujet donné, mais aussi sur des paramètres à long terme, comme la confiance dans les institutions et le processus politique.
Lien entre les termes utilisés pour la recherche et la désinformation
Les moteurs de recherche jouent un rôle important lorsque les personnes sont confrontées à des événements nouveaux et à des évolutions inattendues. La pandémie de coronavirus en est un bon exemple. Une étude soutenue par l'OFCOM a examiné quelles sources et quels contenus l'algorithme de Google rend particulièrement visibles (étude 1). Elle révèle qu'en fonction des mots clés utilisés, les résultats de recherche affichent plutôt des sources informatives, ou renvoient plutôt à des contenus qui au mieux livrent la désinformation sans la contrebalancer, au pire la propagent activement.
Illustration: Influence des mots-clés sur les résultats de recherche. Proportion des sources dans les 10 premiers résultats (en %)


Bleu: La désinformation est mentionnée et réfutée.
Jaune: La désinformation est mentionnée, mais pas réfutée.
Rouge: Le page propage de la désinformation
Quelle est notre capacité à reconnaître la désinformation?
Si les mots-clés utilisés ont un effet aussi important sur les résultats, la question des compétences numériques devient d'autant plus importante. Dans quelle mesure les utilisateurs en ligne sont-ils capables de distinguer l'information de la désinformation? Une autre étude montre que la population suisse ne dispose pas de compétences pas très élevées en matière de médias. Les évaluations d'un test complet révèlent que la moyenne se situe tout juste à 5,9 points sur 19 possibles (étude 2).
Les personnes testées devaient par exemple classer différents reportages d'actualité en fonction de leur importance politique et sociale pour la Suisse. Elles devaient également évaluer si la "news" présentée était une information, une publicité, une opinion ou une fausse information. De fait, bon nombre d'entre elles ont été incapables de reconnaître les contenus de désinformation. De plus, comme le montre une autre étude (étude 3), même si elles y sont parvenues, cela ne les a pas empêchées de transmettre ces contenus et de renforcer ainsi à leur diffusion,
Effets à court et à long terme
Compte tenu du fait que les algorithmes contribuent à la visibilité aussi bien de l'information que de la désinformation, et qu'en plus les utilisateurs ont du mal à distinguer l'une de l'autre, les effets de la désinformation constituent le sujet d'une autre étude. La recherche menée fournit quelques résultats sur les effets à court terme. Des informations fausses ou trompeuses peuvent influencer les comportements individuels tels que la volonté de se faire vacciner ou les intentions de vote - et elles ont tendance à être d'autant plus crues qu'elles sont vues, lues ou entendues plusieurs fois. A contrario, si les personnes se sentent déstabilisées par la désinformation, leur confiance dans les contenus d'information, en particulier ceux diffusés sur des plateformes numériques, diminue.
Les effets à moyen et long terme, qui sont particulièrement importants dans le contexte d'élections et de votations, restent encore largement méconnus, notamment parce que ce sujet de recherche exige une mise en œuvre méthodologique particulièrement exigeante. L'OFCOM s'y intéressera dans le cadre d'un programme de recherche pluriannuel, favorisant ainsi une meilleure compréhension de la désinformation dans une sphère publique numérisée.
Afin de mieux comprendre le phénomène de la désinformation, l'OFCOM a lancé ces dernières années deux appels à projets et invité les chercheurs à soumettre des propositions. L'office a également soutenu plusieurs études. Les rapports finaux de ces cycles présentent une image différenciée, dans une perspective interdisciplinaire, qui rassemble des connaissances issues des sciences sociales, de la psychologie, de la linguistique informatique et du droit. Les études ont été publiées sur le site internet de l'OFCOM: Etudes diverses
Informations complémentaires
- Etude 1: Mykola Makhortykh, Maryna Sydorova, Aleksandra Urman, Franziska Keller, Silke Adam. Algorithmic content selection in Switzerland - a study of Google and YouTube.
- Etude 2: Jan Fivaz et Daniel Schwarz. Les compétences de la population suisse en matière de médias. Etude pilote représentative pour la Suisse alémanique et la Suisse romande
- Etude 3: Achim Edelmann et Christian Müller. Preuve expérimentale du partage et du signalement de la désinformation en Suisse, en France et en Allemagne.
Dernière modification 10.12.2024